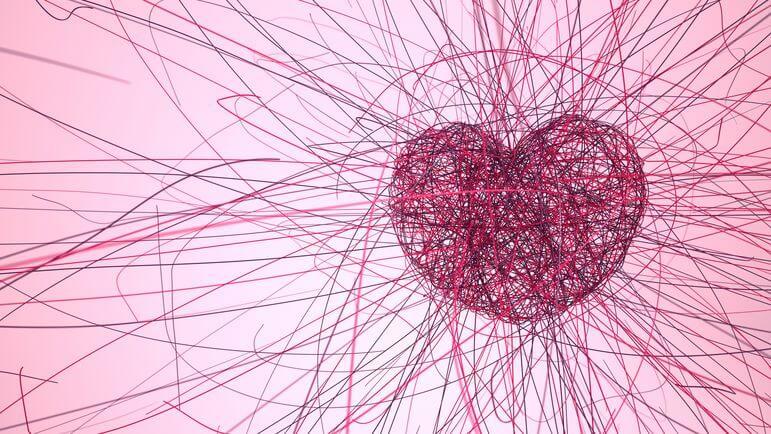
Une étude en Ehpad sur près de 5 000 patients porteurs d’une fibrillation atriale.style-photography / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Une équipe américaine a mené une étude sur près de 5 000 patients porteurs d’une fibrillation atriale et séjournant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Parmi eux, 27 % recevaient des anticoagulants oraux, comme il est préconisé pour la prévention des accidents ischémiques liés à ce trouble du rythme. Malgré tout, 32 % étaient traités par antiagrégants plaquettaires et 12 % par les deux types de molécules. Aucun antithrombotique n’était prescrit dans 29 % des cas.
Ces chiffres confirment ainsi la sous-utilisation déjà rapportée des anticoagulants chez les sujets âgés atteints de fibrillation atriale. Ils mettent aussi en évidence la surprescription non justifiée des antiagrégants plaquettaires dans cette population.
Les recommandations en vigueur stipulent pourtant l’efficacité supérieure de l’administration d’anticoagulants oraux dans ce contexte et attestent l’absence de surrisque hémorragique par rapport aux antiagrégants plaquettaires.
Les auteurs de l’étude soulignent que leurs résultats pourraient constituer l’opportunité de déprescrire les antiplaquettaires au cours de la fibrillation auriculaire, a fortiori lorsqu’ils sont associés aux anticoagulants.
Les personnes âgées vivant en maison de retraite médicalisée présentent souvent une fibrillation atriale (FA). Cette population est aussi à risque d’hémorragie, le traitement de ce trouble du rythme reposant sur les anticoagulants, dans le but de limiter le risque d’accident vasculaire ischémique [1, 2].
Néanmoins, diverses études ont fait état d’autres pratiques comme la substitution des anticoagulants par des antiagrégants plaquettaires (AAP) dont on sait pourtant leur inefficacité à prévenir la survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC), voire l’association de ces deux types de médicaments.
Si ces choix thérapeutiques ne semblent pas si rares, leur justification n’apparaît pas toujours évidente et ils peuvent jouer un rôle dans la sous-prescription fréquente des anticoagulants oraux (ACO) au cours de la FA.
C’est dans ce contexte que Darae Ko et al. [3] ont mené, aux États-Unis, une étude transversale dans plus de 700 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) situés dans 40 États différents.
Les résidents inclus devaient avoir séjourné au moins 100 jours dans l’établissement et avoir un score de risque thrombo-embolique CHA2DS2-VASc ≥ 1 pour les hommes et ≥ 2 pour les femmes.
À partir de leurs dossiers électroniques, il a été possible de renseigner les prescriptions d’ACO (warfarine, apixaban, rivaroxaban, dabigatran) et d’AAP (aspirine, clopidogrel, prasugrel, ticagrélor).
Les patients ont été stratifiés selon qu’ils recevaient à la fois des anticoagulants oraux et des antiagrégants plaquettaires, seulement des ACO, seulement des AAP ou bien aucun traitement antithrombotique.
Une analyse multivariée spécifique a également été effectuée dans un sous-groupe de résidents dénués de pathologie cardiaque ischémique et d’artériopathie périphérique afin d’identifier les facteurs associés aux différentes prescriptions.
Seulement 40 % des patients sous anticoagulants
Parmi les 4 752 patients de l’étude ayant une FA, d’âge moyen 78,5 ans, 12,2 % recevaient à la fois des anticoagulants oraux et des antiagrégants plaquettaires (n = 582), 26,9 % des ACO seuls (n = 1 281), 32 % uniquement des AAP (n = 1 523), tandis que 28,7 % (n = 1 366) n’avaient aucun traitement antithrombotique. L’antiagrégant de loin le plus utilisé était l’aspirine (91 %).
Par ailleurs, il a été noté que 45 % (n = 937) des participants n’avaient ni cardiopathie ischémique ni artériopathie périphérique.
Dans l’analyse par régression logistique, l’utilisation d’antiplaquettaires et l’absence de traitement étaient associées à une démence (Odds Ratio [OR]: 1,39) ou à des troubles cognitifs modérés (OR : 2,14) à sévères (OR : 2,59) par comparaison avec les ACO.
Des prescriptions d’antiagrégants non justifiées
Ces résultats montrent à l’évidence la sous-prescription des anticoagulants avec seulement 27 % des résidents recevant uniquement ces médicaments et 12 % un traitement combiné.
A contrario la prescription d’antiagrégants antiplaquettaires seuls ou en association était bien plus fréquente et surtout non justifiée en l’absence de pathologie ischémique rapportée (45 % des cas).
Les motifs sous-tendant ces attitudes n’ont pas été abordés par les auteurs, non plus qu’ils n’ont commenté la part plus élevée de troubles cognitifs dans le sous-groupe de patients sans pathologie ischémique. Tout au plus supposent-ils la possible crainte d’événements hémorragiques chez des patients âgés aux multiples comorbidités.
Pourtant, dans les dernières recommandations européennes de 2024 [2], il est clairement rappelé que les antiagrégants plaquettaires sont moins efficaces que les ACO pour prévenir la survenue d’accidents ischémiques alors que le risque de saignement n’apparaît pas différent : « ces médicaments ne devraient pas être utilisés pour la prévention des AVC et peuvent conduire à des effets délétères (en particulier chez les sujets âgés ayant une FA) ». Quant à l’association des ACO et des AAP, elle n’a pas montré d’avantage en termes de prévention des AVC tout en majorant le risque hémorragique.
Pour Darae Do et al, la prévalence élevée de l’utilisation des antiplaquettaires, au premier rang desquels l’aspirine, suggère l’opportunité de déprescrire des molécules susceptibles de majorer la survenue de saignements dans une population déjà à haut risque. Une position partagée par Utibe Essien et Michelle Keller [4] dans leur commentaire, qui rappellent également qu’alors que la plupart des études se focalisent surtout, à juste titre, sur la trop faible prescription d’anticoagulants, il y a eu peu de travaux, comme celui de Darae Do et al. soulignant le recours trop fréquent à des médicaments potentiellement inappropriés, en l’occurrence à des antiagrégants plaquettaires chez des sujets âgés.

 5 minutes
5 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire

Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.